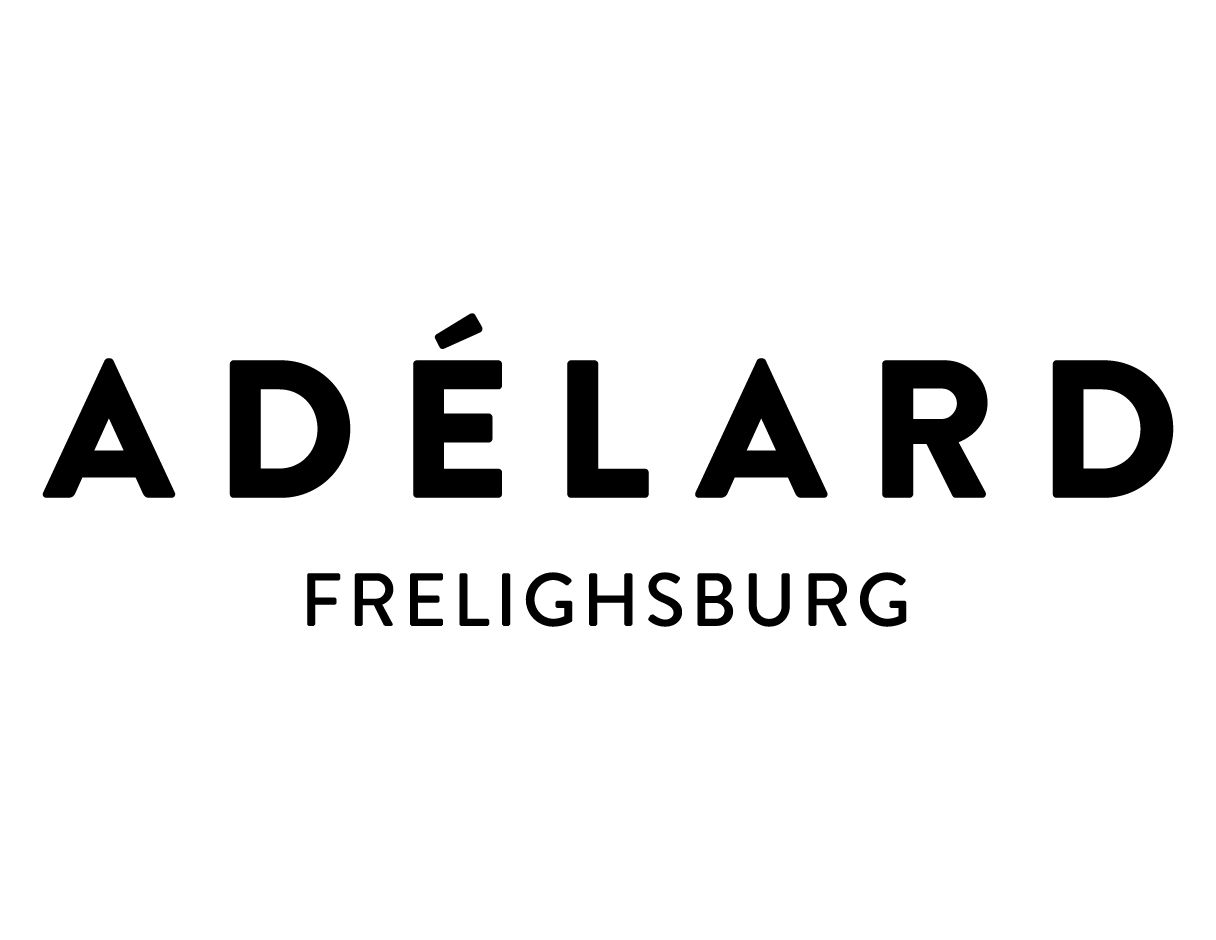en immersion du 31 août au 13 octobre 2019
VALÉRIE POTVIN
Entre roc et faïence
Elle connaissait tous les sentiers de la forêt, tous les raccourcis qui menaient à la rivière Manicouagan, mousse et lichens sur le chemin de son paradis perdu. Été comme hiver, au rythme des marées, elle marchait à la conquête des rochers de granites aux trois couleurs ou de la plage au sable foncé. À Baie-Comeau, petite ville industrielle de 30 000 habitants, elle grandit avec la nature et les grands espaces sauvages de la Côte-Nord. À l’adolescence, l’immensité tout à coup se rétrécit. Elle quitte la bourgade de son enfance pour la grande capitale où elle terminera ses études. Après un DEC et un BAC en art plastique, elle amorce sa vie d’artiste professionnel à Québec.
Elle accumule les projets à grandes dimensions, explore des thèmes en lien avec l’actualité, les enjeux sociaux et les diverses souffrances humaines. Sensible aux autres et à son environnement, préoccupée par la fragilité de la terre, elle plonge les deux mains dedans. Biner, semer, désherber, arroser, cueillir, cuisiner les légumes de son jardin la garde ancrée dans l’essentiel. C’est souvent là, en accomplissant ces gestes simples et routiniers, que germent ses grandes idées. Et des grandes idées, ce n’est pas ce qui lui manque. Ce sont les moyens de les réaliser qui font défaut. Malgré la précarité du métier, elle persiste. Plusieurs fois, arrivée au carrefour, elle choisira à nouveau la voie de la création.
Elle a toujours favorisé le travail avec du matériel naturel, recyclé ou à faible empreinte écologique. Pour son projet Les fous, elle crée deux personnages en tissu, vieux vêtements, restes de peinture et plumes de fous de Bassan ramassées sur la plage de Percé. Avec son installation Crème, en plus du bois récupéré et du plâtre, cette fois, elle utilise de la meringue pour recouvrir son personnage. Les produits comestibles, sucre, gâteau, blanc d’œuf, caramel deviennent alors matière à explorer. Respecter son propre écosystème, son rythme et ses limites physiques et psychologiques deviennent aussi une priorité; trouver l’équilibre entre roc et faïence, entre vigueur et fragilité.
Après sept ans de recherches et d’expositions à Québec, au Brésil et en Allemagne, elle retourne à l’Université Laval compléter une maîtrise interdisciplinaire en art. Son projet de maîtrise, Monstres, assemblages sculpturaux, étonnants et audacieux, met en scène les rapports de pouvoir sexuel. À travers des corps à l’esthétique étrange, déformés, démembrés, contraints, les mains demandent de l’aide, les corps cabrés appellent au secours. Bien que ce ne soit pas son objectif, son expression artistique singulière dérange, suggère différentes sensations souvent contradictoires, suscite la controverse.
Durant sa résidence chez Adélard, l’artiste apprivoise le petit format. Elle moule son visage pour en faire des masques, en sucre blanc, en fibre de bois, en glace, en gâteau, en plâtre. Elle veut filmer la détérioration de la matière, attirer les crapets-soleils du petit lac de chez Laure Waridel, observer la réaction sous l’eau. Mais les éléments ne réagissent pas toujours comme prévu. Les poissons ne sont pas au rendez-vous. Le courant est trop fort. Elle recommence, persévère, cherche encore. Elle plonge à nouveau sa caméra au fond de la rivière aux Brochets qui, tout à coup, lui offre un spectacle inattendu. Les petites pierres colorées se soulèvent, tourbillonnent comme des flocons de neige. Les écrevisses résistent, s’agrippent aux longues herbes aquatiques.
En parallèle, elle modèle une femme en argile qui n’est pas sans rappeler la forme du mont Pinacle au cœur du paysage de Frelighsburg. Elle façonne avec attention et bienveillance le corps d’une femme nue. Au séchage, la sculpture se casse, la tête, une jambe, un bras. Femme brisée. L’artiste la répare, remet de la barbotine, recolle les morceaux. Avec son appareil photo, elle l’immortalise plongée au fond d’un bassin d’eau. Peu à peu, l’argile se dissout, le corps se décompose, redevient glaise, disparaît. Les centaines de photos, couleur gris acier, prises durant la détérioration, serviront peut-être à un montage-installation. Elle y réfléchit. Le nombre de photos sélectionnées pourrait correspondre à un chiffre. Un chiffre lié à une réalité, au nombre de femmes autochtones disparues, au nombre de femmes tuées en une seule année sous les coups d’un conjoint ou encore au nombre d’avortements clandestins qui encore aujourd’hui provoquent la mort d’une femme à toutes les 9 minutes dans le monde. L’oeuvre est en devenir. Elle se décuple en deux, en trois, en quatre possibilités.
Cette fois, c’est la caméra qui tourne autour de ce corps d’argile. La femme-sculpture qu’elle a moulé en plâtre, brûle au milieu d’une forêt miniature reconstituée avec les ressources de l’endroit, hydrangées et spirées, bran de scie, épines de pin, roches. À travers les arbres en feu, on reconnaît le corps blanc de la femme-sculpture qui noircit sous nos yeux. Ici l’œuvre évoque à la fois le récent fait divers d’une femme de Québec immolée par son conjoint et la forêt amazonienne brésilienne qui brûle encore aujourd’hui au rythme de 110 terrains de football à l’heure. Elle pourrait aussi faire référence à ces femmes sorcières qu’on envoyait aux bûchers. Dans la mouvance de l’éveil collectif Me too, Valérie Potvin témoigne à sa manière. Avec courage et conviction, elle transgresse ses propres tabous, sa propre censure pour rendre hommage à ces femmes d’hier et d’aujourd’hui, violentées, abusées, brisées. Le résultat est cru et brut mais empreint de respect, de pudeur et d’une infinie douceur pour son sujet.
Après son immersion chez Adélard, son projet amorcé ici dans l’atelier de Frelighsburg, se poursuivra à la résidence de longue durée au Centre ZK\U de Berlin, lieu de production, d’expériences artistiques et de recherches sociales où elle a été sélectionnée. Du petit format, son projet redeviendra grand, immense comme le pays de son enfance, un projet d’envergure en milieu urbain.
Isabelle Hébert, octobre 2019
photos : Valérie Potvin